Je suis serveuse, en quoi le 15-5-7 ça me concerne? Et comment y arriver?
Depuis que j’ai 14 ans, je travaille dans l’industrie de la restauration. Ça veut dire que depuis que j’ai 14 ans j’en ai vu de toutes les couleurs de passe droit et de salaire de merde. Mais j’ai eu de la chance, j’ai commencé hôtesse et ai toujours eu un peu de pourboire. Arrivée à l’étape de l’appartement, j’étais serveuse, ce qui me garantissait un coussin financier confortable.
Au printemps passé, pendant que je cherchais une job, je n’ai pas réussi à en trouver une tout de suite dans le service et c’est là que j’ai vécu, ou plutôt tenté de vivre, au salaire minimum. J’ai pas du tout la théorie qui vient derrière le 15$/h, mais j’ai le vécu. C’est pas vrai qu’à 10,55/h on réussi à payer son loyer, à bien manger et à se déplacer. Le salaire minimum à 15$/h, ça veut dire arrêter de se demander si j’ai assez d’argent pour prendre le métro à la place de marcher 1 heure l’hiver à -40°C. Ça veut aussi dire que, pour les parents, une job chacun à 40h/semaine pourrait être suffisante.
On va se le dire, j’ai 21 ans, pas d’enfants et aucune autre responsabilité que de m’occuper de moi-même. Si dans ma situation c’est difficile, j’imagine même pas c’est quoi pour mes collègues qui ont des enfants.
Comme salariée à pourboire ça veut dire quoi le 15$/h ?
Dans l’industrie dans laquelle je travaille, on retrouve deux positions envers le salaire minimum à 15$/h. Il y a les gens pour, qui souvent travaillent en cuisine et il y a nous, les serveuses qui, franchement, à moins de travailler dans un casse-croûte, nous retrouvons bien au-dessus de ça avec le pourboire. Nous voyons donc difficilement ce qu’il y a à gagner avec le 15$/h, mais plutôt ce qu’il y a à perdre.
Comme serveuse, on vante souvent l’idée que le service c’est un peu comme gagner à la loto ; on fait la palette. J’y crois presque encore, du moins c’est tellement ancré que je veux y croire. Mais quand j’y pense, à part les filles de mon âge, qui souvent commencent, des femmes et hommes émancipés et à l’aise financièrement dans leur job tellement payante dans le service, j’en ai jamais vus. Ma première job c’était une job géniale : petit restaurant haut de gamme en bordure de Québec, avec comme serveuses des femmes dans la quarantaine en montant et dans les petits postes, des gens de 14 ans, comme moi à l’époque. Pis je m’en rappelle de ces femmes-là, des anges, super gentilles, qui sont dans l’industrie depuis leurs 14 ans. Sauf que ce sont aussi des femmes qui en ont des histoires à dormir debout sur l’industrie. Des femmes qui ont jamais un congé de leur vie, qui se sont fait renvoyées quand elles sont tombées enceintes, qui ont des problèmes de consommation, des problèmes d’argent par dessus la tête, des problème de santés, mais pas d’assurance, rien, que des peanuts.
Pis dans ma deuxième job, on avait toutes entre 20 et 25 ans. On avait de l’argent à dépenser et les quatre jours de 12 h de file sont plus faciles à toffer avec quelque chose dans le corps qu’à jeun. Fait que quand on y pense, c’est normal que 20 ans plus tard dans cette industrie, on en ait des problèmes pis qu’on soit autant poquées. La loto du service je veux vraiment y croire, parce que c’est ce qui fait qu’on se dit que notre job est moins pire que celle du cook. Mais si c’est vraiment la loto pis que pour la gagner on se maganne, je vois pas en quoi le tip en vaut la chandelle.
Pis en plus ce qu’on oublie c’est qu’on cotise sur notre retraite, sur le chômage, sur les vacances, à 9,05$/h. Dans le fond on oublie que dans le moment, on y arrive en masse, mais que dès qu’on tombe malade, que notre boss nous trouve pu assez cute, qu’il ferme ou qu’on veut des vacances, on se retrouve avec des peanuts et, tout d’un coup, on y arrive pu pantoute.
Et on va se le dire, le tip que je fais est pas juste du à mon sourire, souvent il y a le «est-ce que ma bouffe était bonne» et «est-ce que ça a pris 1h ou 20 minutes avant de recevoir ma bouffe». Depuis 7 ans je suis dans l’industrie et depuis 7 ans que je vois les serveuses et les cuisiniers se battre sur la question de salaire. Ce serait tellement plus sain et juste qu’on soit toutes à 15$/h et de partager le pourboire. Pas juste ça, le «j’accepte la familiarité malaisante des clients» deviendrait tellement moins nécessaire, on pourrait respirer, et garder la même qualité de vie.
Pourquoi 5 semaines de vacances payées et 7 jours de congés maladies payés ?
Le 15$/h c’est vraiment sur la coche quand on a un salaire de 10,55$/h, c’est à peine si on réussit à y croire. Sauf que 5 jours semaine, 52 semaines par années, à moins que t’aie la chance d’être là depuis plus d’un an et que tu as 2 semaines de moins, c’est juste pas sain. Ça sert à quoi 15$/h quand on peut pas souffler ? Pis pourtant nos boss eux s’en offre des vacances, sur notre dos. Parce qu’on va s’entendre que si mon boss fait autant d’argent, c’est pas parce qu’il travaille plus que moi, c’est parce qu’il a eu l’idée et les ressource pour partir son entreprise. Les 5 semaines de vacances, c’est en gros d’aller chercher notre du en tant que force de travail. On crée le profit, on peut demander à en profiter aussi. C’est aussi simple que ça.
Ça fait 7 ans que je travaille dans la restauration, ça veut dire que jsais pas c’est quoi un congé maladie. Non seulement prendre congé parce qu’on est malades nous vaut souvent un avertissement écrit ou la perte de l’emploi, mais ça veut aussi dire une perte de journée de salaire et ça, on peut pas se le permettre.
Pis en fait, la majorité des gens vont dire que c’est DÉ-GUEU-LASSE de savoir que la majorité des employés de restauration prennent pas congé quand ils ont la gastro, parce que «hey, jla mange cette bouffe là moi !». Ben oui. C’est dégueulasse, mais le loyer se paye pas tout seul, sorry. Les 7 jours de congés maladies payés c’est comme les 5 semaines de vacances : c’est un gros minimum. Et là on demande pas à ce qu’ils soient payés seulement s’ils sont pris, non. On demande que, pris ou pas, les congés maladies soient payés. Ça veut dire : pas d’excuse de la part du patron sur le fait qu’il y avait pas de papier du médecin et pas besoin de justification pour se le faire payer.
Comment ça va être possible d’y arriver ?
Le 15-5-7, c’est possible et c’est un gros minimum. Mais, la seule façon que ça arrive de façon permanente, c’est qu’on s’organise sur nos milieux de travail. Quand on voit des gains par les élections, ces gains sont temporaires s’ils décident de le donner, ils peuvent décider de l’enlever. On l’a vu souvent, comme le Parti québécois qui a longtemps été mis de l’avant par les syndicats pendant les élections. Mais dans les faits, c’est le parti qui a mis en place le plus de Lois spéciales. La rhétorique électorale j’y crois pas, ça fait 7 ans que jvois le monde de mon industrie dans marde et maintenant que jle suis aussi, j’y crois encore moins. La politique des gens riches me concerne pas, leurs projets me concernent pas, la mienne est sur mon milieu de travail et prend acte avec mes collègues en opposition aux intérêts de nos patrons.
Quand on passe par la base et par l’auto-organisation des milieux de travail, on crée un momentum. Ce qui se passe, c’est un mouvement. Quand on s’organise sur nos milieux de travail, on s’organise avec nos collègues et nos collègues s’engagent dans la lutte contre leur adversaire direct : le patronat. Ce qu’on veut, c’est pas quelques personnes qui convainquent les masses. Le problème avec la tentative de «convaincre», c’est qu’un autre peut aussi le faire contre vous. Ce qu’on veut, c’est que ça vienne de nous ; parce que quand ça vient de la base, de nous, le gain est solide. Quand on se bat pour quelque chose, qu’on le gagne, si on nous l’enlève, on réagit. Quand on a l’impression qu’on nous l’a donné, si on le perd, on se résigne.
À l’IWW on croit que c’est par l’organisation qu’on peut vraiment gagner et renverser le rapport de force. On s’organise sur nos milieux de travail avec nos collègues. Dans la théorie, c’est vraiment beau de se dire que ça va se faire par les élections, mais le vrai pouvoir est sur nos milieux de travail, pis mes collègues et moi savons ben mieux comment le mettre en place qu’un gouvernement ou que n’importe quel autre groupe qui parle à travers son chapeau. À l’IWW on fonctionne par la base. En gros, quand à ma job on va se syndiquer, on va le faire dans nos propres termes, on va avoir nos propres revendications et nos moyens d’actions. La section locale intersectorielle n’aura aucun droit de décision, sauf si on le demande. Si on veut pas aller en grève, on ira pas. Mais si au contraire on veut y aller, watch out, y a personne qui pourra nous en empêcher.
Ce qu’on fait, c’est parler avec nos collègues, parce leurs problèmes, NOS problèmes, sont ce qui font qu’on se rassemble, pis qu’on se solidarise. J’ai une collègue que si tu lui parles de tes problèmes, elle compatie, mais hell no qu’elle s’embarquera pas dans quelque chose pour toi, ben oui, c’est ça l’individualisme. Mais quand tu lui demande ce qui va mal à job, elle en a gros sur le cœur et elle veut se battre pour ce qui la touche si elle sait qu’elle est pas seule.
Jamais on enverra quelqu’un leader une campagne. À l’IWW on a la célèbre phrase «every worker’s an organizer». Ça vient de nous tous : tout travailleur/toute travailleuse est un organisateur/une organisatrice, ça vient pas d’un comité central, pas d’une assemblée, et si on veut s’organiser on s’organise et on agit. C’est nous qui savons le mieux comment ça doit être sur nos milieux de travail, pas mon boss, pas mon camarade militant, nous ; c’est nous qui pouvons faire que ça soit possible, que ça change. Ce que ça fait, de s’organiser, c’est qu’on devient plus sûrs de nous, on prend les rênes et ça donne le goût d’agir.
Le 15-5-7 on va se le dire, c’est une méchante bonne idée. Sauf que on va aussi se le dire, il y a un superbe pattern dans certaines industries précaires qui veut que l’adversaire c’est pas mon boss, mais mes collègues. Parce que le cuisinier se force pas assez pour faire des belles assiettes pis que X a une section plus payante que moi. Ben oui, on s’est tous fait former dans l’optique de la «compétition naturelle» pis ça donne ça. Pis là, ça, ça brouille un peu les cartes, parce que pour que le 15-5-7 fonctionne, faut qu’on se tienne les coudes. Pis la compétition, ça fait le contraire.
Moi, la seule tactique que j’ai vu fonctionner pour solidariser mes collègues, c’est l’organisation. Pis l’organisation sur des enjeux qui touchaient tout le monde, même mes gérantes. Pis à partir de ça on augmente les demandes, pis les moyens de pressions. C’est pas vrai que dès le début tout le monde va vouloir le 15$/h. Mais un moment donné, quand ça fait des mois, voir des années que tu te bats contre le même adversaire avec tes collègues, sur des problèmes qui t’ont touchés au début, pis des fois pas, pis des fois juste toi pis pas lui, ben tu viens à te demander pourquoi les salaires sont pas plus justes. Ce qui fait que tout d’un coup, parce qu’il m’a aidée quand mon boss faisait du harcèlement, parce que je l’ai aidé quand il a eu besoin d’une hausse de 50 cennes, etc., partager mon tip de façon égale est vraiment plus logique qu’au départ.
Et là on va se le dire, c’est assez réformiste comme demande. Ce qu’on demande c’est pas l’abolition de l’exploitation, ni l’abolition du salariat. On demande juste une plus grande part des profits de nos patrons et un meilleur mode de vie. Sauf qu’à quelque part, en attendant d’arriver aux beaux projets de société qu’on essaie de me vendre à gauche pis à droite, j’aimerais ça pouvoir payer mon loyer, pis j’aimerais ça manger autre chose que les sandwichs qui sont gratuits à ma job. Pis dans tout ça, en voulant le 15$/h pis les vacances et les congés maladies payés, on lutte. Quand on s’organise entre travailleurs et travailleuses, on crée une classe plus forte, on se solidarise et on renverse le rapport de force.
Comme travailleuse, on m’a appris à penser que c’était impossible de changer les choses sauf si je devenais gérante. On m’a appris à critiquer mes collègues qui ne faisaient pas des doubles et à me référer à mes patrons s’il y avait un problème sur le plancher. Avec l’organisation et l’IWW, ce que j’ai commencé à voir, c’est que les intérêts de mes patrons ne sont pas d’avoir un milieu de travail avec une cohésion interne. La compétition entre serveuses et la rivalité cuisine-service est un bon exemple de ce qui sert le patronat. Diviser pour mieux régner, ça vous dit quelque chose ? Ben en voilà une belle illustration !
En s’organisant et en se solidarisant sur nos milieux de travail, on peut rendre possible ce genre de gain. On peut gagner ce qu’on demande. On s’empower et on comprend qu’on mérite encore plus. En renversant le rapport de force, on brise une barrière et on se rapproche de l’abolition du salariat.

Discours de Morgane Mary-Parson, rerprésentante du SITT-IWW Montréal au forum pour le 15-5-7, en février dernier. Publié pour la première fois dans l’édition de Mai 2016 du Combat Syndical.


 nommées ‘’civiles générales’’ (insalubrité, harcèlement, abus et autres préjudices). Les démarches sont donc 10 fois plus rapides, aujourd’hui, pour ceux ou celles qui possèdent le logement que pour ceux ou celles qui l’habitent. Il est notable de spécifier qu’en 1998, le temps d’attente moyen des dossiers de causes civiles générales était d’approximativement 3 mois. Nous pouvons voir que la majorité des procédures juridiques cheminant à la Régie du logement font suite aux demandes d’un ou d’une propriétaire, puisqu’ils et qu’elles déposent 88% des plaintes, dont 62% pour non-paiement d’un loyer, et que 85% des plaintes venant des locataires sont d’ordre civiles générales. Évidemment, étant donné la si mince représentation des moins nanti-e-s et du temps d’attente suffisamment long pour qu’un déménagement survienne dû à la fin d’un bail, leurs demandes finissent souvent par tombées, complètement ou en partie. Selon Me Johnson: ‘’Lorsque les locataires changent de logements, les demandes faites sur les rénovations du logement ou les baisses de loyers tombent, disparaissent’’; C’est-à-dire qu’il ne reste généralement que les demandes de dédommagements moraux qui tiennent, et elles sont les plus difficiles à démontrer juridiquement. Ajoutons que pour toutes plaintes, il est primordial pour le ou la plaignant-e de prouver toutes formes de désagréments, mais
nommées ‘’civiles générales’’ (insalubrité, harcèlement, abus et autres préjudices). Les démarches sont donc 10 fois plus rapides, aujourd’hui, pour ceux ou celles qui possèdent le logement que pour ceux ou celles qui l’habitent. Il est notable de spécifier qu’en 1998, le temps d’attente moyen des dossiers de causes civiles générales était d’approximativement 3 mois. Nous pouvons voir que la majorité des procédures juridiques cheminant à la Régie du logement font suite aux demandes d’un ou d’une propriétaire, puisqu’ils et qu’elles déposent 88% des plaintes, dont 62% pour non-paiement d’un loyer, et que 85% des plaintes venant des locataires sont d’ordre civiles générales. Évidemment, étant donné la si mince représentation des moins nanti-e-s et du temps d’attente suffisamment long pour qu’un déménagement survienne dû à la fin d’un bail, leurs demandes finissent souvent par tombées, complètement ou en partie. Selon Me Johnson: ‘’Lorsque les locataires changent de logements, les demandes faites sur les rénovations du logement ou les baisses de loyers tombent, disparaissent’’; C’est-à-dire qu’il ne reste généralement que les demandes de dédommagements moraux qui tiennent, et elles sont les plus difficiles à démontrer juridiquement. Ajoutons que pour toutes plaintes, il est primordial pour le ou la plaignant-e de prouver toutes formes de désagréments, mais

 protester contre les pénibles conditions des logements et de leurs occupant-e-s.
protester contre les pénibles conditions des logements et de leurs occupant-e-s. 
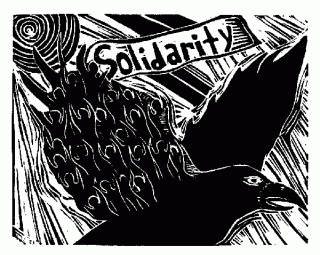

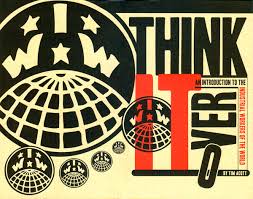
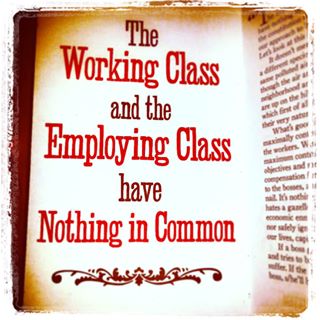 Cela ne veut dire que les travailleurs et travailleuses et les patrons sont des espèces différentes, qu’ils et elles ne respirent pas le même air pollué et boivent la même eau, même si l’eau et l’air d’un quartier ouvrier sont bien plus dégueulasses que sur la colline. Cela implique que les deux classes, qui existent bel et bien, sont en opposition à même leur nature.
Cela ne veut dire que les travailleurs et travailleuses et les patrons sont des espèces différentes, qu’ils et elles ne respirent pas le même air pollué et boivent la même eau, même si l’eau et l’air d’un quartier ouvrier sont bien plus dégueulasses que sur la colline. Cela implique que les deux classes, qui existent bel et bien, sont en opposition à même leur nature.