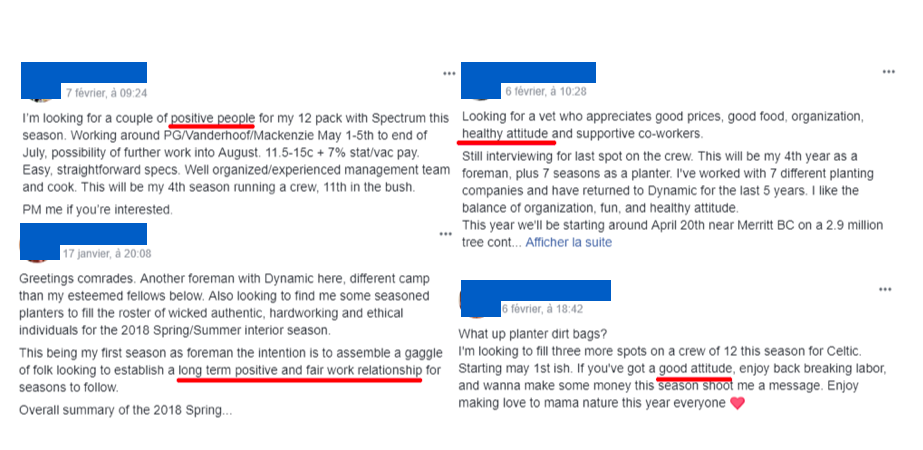Syndicat sous le radar
Les réussites visibles
Quand on parle de syndicats, qu’ils soient à l’IWW ou ailleurs, on pense généralement à de grosses bannières bien visibles. Chez nous, les noms qui frappent le plus comme des exemples de réussites sont sans doute le Starbuck’s Workers Union qui a mis l’IWW sur la map au début des années 2000 ou encore les récentes campagnes menées par le Syndicat des travailleurs et travailleuses du Frite Alors et celui des travailleurs et travailleuses du milieu associatif en éducation, tous deux affiliés à la section locale de Montréal.
La pointe de l’iceberg syndical
Mais si ce n’était là que la pointe de l’iceberg? Dans la formation d’organisation 101, on nous amène à discuter et débattre de la définition la plus englobante qu’il serait possible de donner d’un syndicat. Après y avoir assisté trois fois en tant que participant et 5 fois en tant que formateur, je peux vous garantir qu’à presque tout coup nous arrivons à la même réponse : un syndicat c’est quand deux travailleurs ou travailleuses ou plus s’unissent pour améliorer leurs conditions de travail et celles de leurs collègues.
Si on regarde du côté du Syndicat des travailleurs et travailleuses du Frite Alors de la rue Rachel, par exemple, on remarque que l’action syndicale commença longtemps avant que le S-Word ne soit prononcé. Dès le printemps ils et elles mettaient de l’avant des actions collectives pour avoir droit à de la climatisation dans le restaurant, une demande qui fut suivie de quelques actions, puis par de nouvelles revendications.
Dernièrement, le Combat Syndical publiait un article parlant de salarié-es de l’industrie de l’animation 3D qui ont réussi à substantiellement améliorer leurs conditions de travail, mais l’équipe de la rédaction aurait aussi pu se pencher sur de nombreux autres exemples locaux. Des salarié-es de l’industrie de la livraison qui ont réussi à obtenir de meilleurs outils pour travailler et une augmentation de salaire de 20 %, des salarié-es de la santé qui ont réussi à limiter les dommages du modèle Lean dans leur établissement, des salarié-es de la restauration qui ont obtenu des augmentations de salaire et la réparation de plusieurs de leurs instruments de travail, des salarié-es d’un centre d’appels qui ont obtenu eux et elles aussi une augmentation de salaire.. Ce sont là des exemples d’une solidarité victorieuse et qui la plupart du temps resta néanmoins dans l’ombre. Ils sont le résultat de l’union des travailleurs et travailleuses concerné-es, de nombreuses heures de réunion nécessitant la participation de tous et chacune, et souvent de plusieurs actions, bref de l’action syndicale en bonne et due forme!
Sur le terrain
Un autre exemple vers lequel il est possible de se tourner est celui du Stardust Family United (SFU) à New-York. Bien que leur syndicat, dont l’existence fut rendue publique en août dernier eu à faire face à une répression monstre, on peut constater deux choses. La première est qu’en dépit des dizaines de congédiements qui suivirent la sortie publique du SFU, ce n’est que la partie émergée du syndicat qui fut congédiée. Si cette dernière a maintenu la pression en organisant des lignes de piquetage jour après jour, d’autres travailleurs et travailleuses de chez Stardust, de leur côté, ont continué à travailler sous le radar et à aller chercher de nombreux gains. D’ailleurs, nous apprenions dernièrement que deux des vétérans et vétérantes de la campagne d’organisation new-yorkaise poursuivaient leurs activités ailleurs. Forcé-es de déserter les lignes de piquetage pour se trouver un autre travail, l’une d’entre elles participa à un refus collectif de signer une nouvelle politique de discipline qui était littéralement draconienne, tandis que l’autre coordonna une sorte de marche tournante sur le patron, au sujet des pourboires laissés par carte de crédit et volés des serveurs et serveuses. La victoire fut immédiate. À l’IWW, nous disons souvent que ce ne sont pas les lieux de travail que nous organisons, mais plus tôt les travailleurs et les travailleuses directement. Qu’un des objectifs principaux derrière nos campagnes d’organisation est de créer plus d’organisateurs et plus d’organisatrices qui pourront mener la lutte sur leur actuel lieu de travail comme dans tous les autres qu’ils et elles croiseront au fil de leur vie.
Sortie publique ou pas sortie publique?
Il y a quelque chose de très médiatique, de très glamour à faire une sortie publique, mais ce n’est pas la seule manière de s’organiser en tant que syndicat et de gagner en tant que syndicat. Aider ses collègues à prendre pleinement conscience du pouvoir que notre patron exerce sur notre vie, puis les amener à réaliser toute la force qu’il est possible d’avoir lorsque nous nous unissons, pour ensuite prendre les actions qui s’imposent, c’est une victoire en soit! Ce sont là des exemples de travailleurs et de travailleuses qui se sont empoweré-es, ont vu leurs conditions de travail s’améliorer et se sont outillé-es pour pouvoir recommencer à se battre ou qu’ils et elles soient! En un mot : Du Syndicalisme.
Mathieu Stakh


 Les sous-titreurs et sous-titreuses travaillant pour le géant des télécommunications Ericsson, qui produit des sous-titres destinés à la télédiffusion au Canada et au Royaume-Uni, ont vu
Les sous-titreurs et sous-titreuses travaillant pour le géant des télécommunications Ericsson, qui produit des sous-titres destinés à la télédiffusion au Canada et au Royaume-Uni, ont vu  Les différentes communautés sourdes et malentendantes du Canada méritent mieux que des sous-titres créés par des travailleurs et travailleuses fatigué.e.s, affamé.e.s et lésé.e.s.
Les différentes communautés sourdes et malentendantes du Canada méritent mieux que des sous-titres créés par des travailleurs et travailleuses fatigué.e.s, affamé.e.s et lésé.e.s.