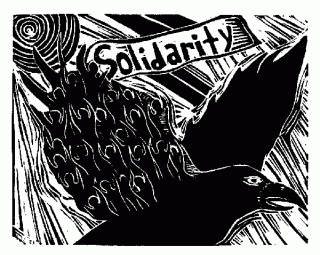Solidaire des arrêté-e-s de la Loi Travail
En solidarité avec celles et ceux qui ont lutté et qui luttent encore contre la Loi Travail et « son monde », le SITT-IWW Montréal a organisé une soirée de financement afin d’aider le groupe de Défense Collective (DefCol) de Paris, et ce en offrant un soutient moral et financier aux personnes arrêté.e.s et/ou incarcéré.e.s en lien avec le mouvement qui a débuté ce printemps. Ce montant est bien entendu symbolique, mais il représente une solidarité internationale qui doit être maintenue afin de combattre le système qui nous affame et qui nous plonge dans la précarité.



 Rico, d’Haïti, de Jamaïque, du Népal et des Philippines, et elles ont toutes des histoires similaires à partager. Chacune d’entre elles m’ont révélé l’oppression qu’elles vivaient à la maison. Elles sont forcées de se conformer au rôles de genres et de suivre les standards traditionnels de ce qui définit une femme. Certaines ont tenté de se libérer de ces rôles, mais la pression de leurs entourages et de leurs familles finie généralement par venir à bout de leur volonté. Si certaines réussissent à se battre contre le courant, elles sont systématiquement insultées et stigmatisées, développent une mauvaise estime de soi et sombrent parfois dans l’anxiété et la dépression. J’ai moi-même vécu, et vis encore, des épisodes de détresse émotionnelle. Je me suis sortie d’une dépression en 2013 après six mois de thérapie, et je me bas encore aujourd’hui contre l’anxiété sociale et une mauvaise estime de moi-même. Malgré tout, je réussis à conserver mon intégrité et je continuerai à le faire afin de poursuivre le combat.
Rico, d’Haïti, de Jamaïque, du Népal et des Philippines, et elles ont toutes des histoires similaires à partager. Chacune d’entre elles m’ont révélé l’oppression qu’elles vivaient à la maison. Elles sont forcées de se conformer au rôles de genres et de suivre les standards traditionnels de ce qui définit une femme. Certaines ont tenté de se libérer de ces rôles, mais la pression de leurs entourages et de leurs familles finie généralement par venir à bout de leur volonté. Si certaines réussissent à se battre contre le courant, elles sont systématiquement insultées et stigmatisées, développent une mauvaise estime de soi et sombrent parfois dans l’anxiété et la dépression. J’ai moi-même vécu, et vis encore, des épisodes de détresse émotionnelle. Je me suis sortie d’une dépression en 2013 après six mois de thérapie, et je me bas encore aujourd’hui contre l’anxiété sociale et une mauvaise estime de moi-même. Malgré tout, je réussis à conserver mon intégrité et je continuerai à le faire afin de poursuivre le combat. laisser ces obstacles barrer notre chemin. Je me souviens avoir été pétrifiée la première fois que je me suis exprimée à propos de mes problèmes personnels auprès d’une camarade. Je croyais qu’elle ne me comprendrait pas et que je la dérangerais, mais après lui avoir raconté mon histoire, j’ai vite constaté qu’elle faisait face aux mêmes problèmes et était empathique face à ma situation. Ça a complètement transformé ma vie puisque j’avais auparavant cru que je devais sans cesse attendre afin de parler de ces problèmes à ma thérapeute, mais j’avais tort. Il y a plein de gens autour de nous prêts à écouter et à nous supporter; il n’en tient qu’à nous d’aller vers eux. J’ai fini par comprendre que les problèmes de genres existent toujours et que les obstacles auxquels je dois faire face sont bien réels. À travers des actions toutes simples comme parler de ceux-ci et bâtir des liens, je crois que nous arriveront à créer un collectif de gens déterminés à créer des tactiques afin d’abolir ces oppressions. C’est ainsi que s’est formé Mujeres Libre, qui a réussi à créer une tendance au sein de la Confederación Nacional del Trabajo et de la Federación Anarquista Ibérica afin de faire face au problème d’inégalité des genres. En grossissant leurs rangs, Elles ont fini par se tailler une place de choix au front lors de la révolution espagnole. Nous pouvons faire de même aujourd’hui si nous y mettons nos cœurs et âmes. Plusieurs d’entre nous diront que nos capacités et le climat social d’aujourd’hui rendent une telle chose impossible, mais comment le saurions-nous sans avoir même essayé? C’est pourquoi j’encourage toutes les femmes révolutionnaires à cesser de douter d’elles-mêmes et à engager le combat. Brisons dès maintenant le silence et créons la solidarité dont nous avons besoin.
laisser ces obstacles barrer notre chemin. Je me souviens avoir été pétrifiée la première fois que je me suis exprimée à propos de mes problèmes personnels auprès d’une camarade. Je croyais qu’elle ne me comprendrait pas et que je la dérangerais, mais après lui avoir raconté mon histoire, j’ai vite constaté qu’elle faisait face aux mêmes problèmes et était empathique face à ma situation. Ça a complètement transformé ma vie puisque j’avais auparavant cru que je devais sans cesse attendre afin de parler de ces problèmes à ma thérapeute, mais j’avais tort. Il y a plein de gens autour de nous prêts à écouter et à nous supporter; il n’en tient qu’à nous d’aller vers eux. J’ai fini par comprendre que les problèmes de genres existent toujours et que les obstacles auxquels je dois faire face sont bien réels. À travers des actions toutes simples comme parler de ceux-ci et bâtir des liens, je crois que nous arriveront à créer un collectif de gens déterminés à créer des tactiques afin d’abolir ces oppressions. C’est ainsi que s’est formé Mujeres Libre, qui a réussi à créer une tendance au sein de la Confederación Nacional del Trabajo et de la Federación Anarquista Ibérica afin de faire face au problème d’inégalité des genres. En grossissant leurs rangs, Elles ont fini par se tailler une place de choix au front lors de la révolution espagnole. Nous pouvons faire de même aujourd’hui si nous y mettons nos cœurs et âmes. Plusieurs d’entre nous diront que nos capacités et le climat social d’aujourd’hui rendent une telle chose impossible, mais comment le saurions-nous sans avoir même essayé? C’est pourquoi j’encourage toutes les femmes révolutionnaires à cesser de douter d’elles-mêmes et à engager le combat. Brisons dès maintenant le silence et créons la solidarité dont nous avons besoin.